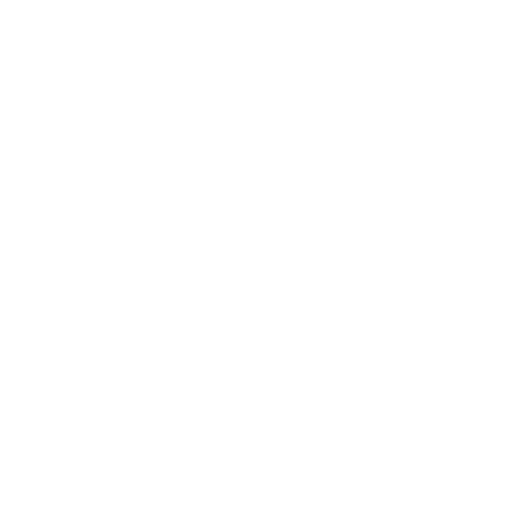Dépôt de nuit
L’ombre me talonne. Comme d’immenses montagnes solitaires, les hangars se dressent un par un le long de mon chemin. J’accélère, toujours en fuite, toujours suivie. Se cachant dans des petits coins, quelques barbecues remplis d’eau attendent la chaleur de l’été. La chaleur… Je rêve un instant entre deux entrepôts désertés pour la nuit. Mais un instant seulement car l’ombre se rapproche.
À l’intérieur, des ateliers sont allumés. C’est bien connu les ombres craignent la lumière, alors je pénètre dans celui des TER. Eclairé par les néons accrochés aux poutrelles métalliques du toit, un train de bleu et de gris est garé : sa tête dans l’atelier, le reste dehors sous les étoiles, sûrement une révision.
Je lève les yeux pour voir si ses fenêtres sont habitées. Personne. A côté une loco en panne attend sur la deuxième fosse pour être réparée. Autour, certains outils sont abandonnés à même le sol, d’autres sont suspendus sur les murs au dessus des établis.
Je renifle, ça sent l’essence, la graisse, l’huile ainsi que d’autres solvants qui piquent les narines. Au loin, j’entends les avertisseurs des trains noctambules qui s’échappent, encore plus loin le bruit de la circulation urbaine gronde. Soudain la lumière s’éteint et des voix disparaissent en discutant. L’atelier est dans l’obscurité. L’ombre est là. Elle s’élargit, m’encercle, murmure à mes oreilles : « A quoi bon ? Viens, suis-moi. ». Je la sens qui s’insinue dans mes bottes.
Non je ne me laisserai pas rattraper. Je cours vers l’extérieur sous la lune ronde. En face de moi, le chemin bitumé avance vers l’imposante passerelle métallique qui enjambe les voies. Ecartelée entre deux mondes, une jambe dans le dépôt de la gare l’autre dans une rue crasseuse de la ville. De rares gilets oranges la traversent, pressés de rentrer chez eux. Sous cette passerelle passent les trains qui roulent à un train d’enfer.
Je suis un sentier de terre qui continue sur la gauche de cette araignée de fer. Il rejoint un mur de pierres qui soutient un talus où pousse une anarchie verte de buissons, d’herbes folles, de ronces en tout genre. Les rongeurs ont élu domicile dans cette jungle. Des trous de mulots s’y disputent la vue sur les voies et les hangars. Le soir, en traversant ce désert ferroviaire, comme moi, on peut aussi voir les longues queues des rats d’égout dépasser du ballast des rails.
J’avais peur des rats – avant.
Adossé au mur, un wagon abandonné dort en rouillant. De violentes couleurs ont jailli des bombes de peinture jusque sur ses parois. Lorsque je m’approche, le wagon ouvre un œil bariolé : « Sale temps, ce soir, hein ? L’humidité rentre dans mes essieux ». J’ai tellement peur et froid que seul un son informe sort de ma bouche. Il fait trop humide pour parler. Wagon m’ouvre sa porte, je m’y hisse difficilement.
À l’intérieur je fais brûler un siège, pour la lumière et la chaleur. J’entends grincer mon ami. Il peste contre la fumée qui l’envahit. « C’est nécessaire ? » demande-t-il. Mais sa question est rhétorique, il le sait : oui ça m’est nécessaire pour survivre. Même si l’odeur du skaï marron brûlé qui est insupportable, nous étouffe, nous fait pleurer aussi.
Pendant ce temps l’ombre me retrouve, profitant d’un nuage qui masque la lumière de la lune. Elle lèche la paroi de mon vieil ami Corail qui proteste : « Va-t’en c’est indécent de me tripoter comme ça ».
Je m’aperçois que c’est le dernier siège qui brûle, il n’y a plus rien dans ce wagon. Même les bouts de papiers, les sacs en plastique volant, les déchets en tout genre, tout a disparu dans mes brasiers nocturnes. Le dernier siège.
Quelques heures de répit me donnent le temps d’écrire ma vie sur les parois intérieures à coup de feutre indélébile noir. On ne sait jamais si quelqu’un me cherche, un dernier fol espoir, un dernier rougeoiement du brasier avant que l’ombre m’assaille. Voilà, la dernière braise a rendu l’âme, l’ombre fond sur moi comme un oiseau sur sa proie. Ça ne sert rien de résister. Je suis fatiguée, le matin est loin. Tout va mal. Il n’y a plus rien, rien.
Je sors.
— Reviens, n’abandonne pas, me souffle mon ami Corail.
C’est trop tard, l’ombre se glisse sous mes cheveux, descend le long de mon corps, vers mes bottes. Elle m’envahit, me soumet. Je marche vers la passerelle, monte dessus et m’arrête au milieu de cette monstrueuse enjambée métallique. Dessous, deux rayons lumineux surgissent en trombe sur les rails : comme un lapin sur une route je me fige hypnotisé par le regard de ce train. Tu vas voir salope ! L’ombre frémit. Je plonge vers les phares en souriant.
©Abigail McDowell (aka Priss)